L. Moullet, Cecil B. DeMille, l’empereur du mauve, Capricci, 2012.
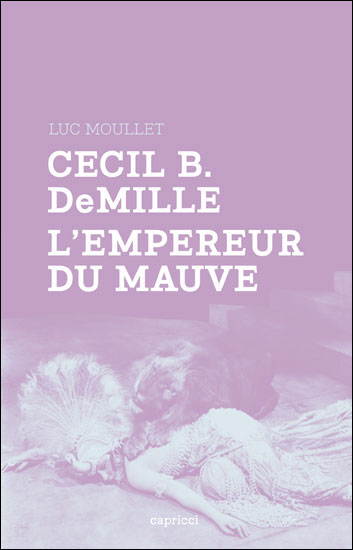
On s’étonne tout d’abord, en prenant le livre en main, qu’une maison d’édition puisse laisser écrire sur une de ses publications, en quatrième de couverture : « En France, les livres qui lui sont consacrés remontent à plusieurs décennies et sont donc dépassés » (je souligne). Certes, il attribue cela au fait qu’à présent on peut voir plus de films de DeMille et donc réévaluer son œuvre, mais la formule est plutôt maladroite, d’autant plus que le livre de Luc Moullet n’est pas particulièrement novateur en termes de plan (la carrière, les thématiques, quelques films : on dirait un livre des années 60) —ne parlons même pas de son auteurisme forcené, qui lui fait écrire : « L’une des caractéristiques les plus évidentes, et les plus étranges, qui marquent son œuvre est son sadomasochisme. Quelque chose d’aussi présent que le thème de l’eau chez Renoir, les femmes opulentes chères à Fellini, les villes portuaires chez Demy ou le suspense hitchcockien. Voilà qui prouve bien, s’il en était encore besoin, que DeMille est un auteur. » (p.81).
Luc Moullet entend donc réévaluer l’œuvre de Cecil B. DeMille à la lumière d’un maximum de films, en prenant ses distances avec la rumeur publique sur l’homme et les clichés critiques sur son œuvre. Mais nous ne voyons pas que Moullet propose une approche bien différente : auteurisme, nous l’avons dit, explications biographiques, économiques ou idéologiques de l’existence de tel ou tel film ou de tel ou tel choix, revue des thématiques habituelles et rebattues du réalisateur.
Certes, il ne s’agit pas de chercher dans ce livre ce qu’il ne prétend pas être : ce n’est pas une étude universitaire, évidemment, ce n’est pas véritablement un essai, plutôt un ensemble de notes, une sorte d’inventaire des choses vues et lues sur DeMille, par une méthode revendiquée d’approximation (Moullet cultive les incertitudes, notamment sur le cinéma muet), d’irrévérence et d’humour qui serait censée nous faire voir les films sous un angle neuf, provocant et insolite.
Mais derrière ce mélange de convenu et de provocation pointent deux thèses sous-jacentes qui entendent, elles, renverser les lectures habituelles de l’œuvre de DeMille. La première est sans doute liée au type d’écriture que Moullet met en œuvre, car elle est en définitive une thèse sur le spectateur. C’est ce que Moullet, très conscient de ce qu’il fait, appelle sa position perverse, et que nous appellerons cynique, du « plus c’est mauvais, plus c’est bon » : c’est par où le film est ridicule, excessif, kitsch, par où donc il est généralement dénigré, qu’il faut l’apprécier (?). Mais quel serait ce sentiment qui le lie au film ? Ce n’est assurément pas de l’amour, peut-être du plaisir, mais je crois bien plutôt qu’il s’agit de mépris. Mépris pour le film, au-dessus duquel il faut se placer, car nous sommes bien plus intelligents que lui, et surtout nous n’en sommes pas dupes. Il prend les films par le bas. Mépris du spectateur alors, car bête et naïf est celui qui prend le film au premier degré et s’y soumet comme un esclave. Ainsi le réalisateur et le spectateur des années 20 étaient sans doute bien plus bêtes que nous, puisqu’ils faisaient et aimaient ces films au premier degré. La seule survie possible des films de DeMille réside alors dans le fait de les prendre au deuxième voire au troisième degré.
Cette attitude concerne les « morceaux de bravoure » des films, autrement dit les effets et le spectacle. Car Moullet semble diviser l’œuvre de DeMille en deux, avec d’un côté les morceaux de bravoure, de l’autre ce qu’il y a de véritablement sérieux dans ses films, et qui constitue la seconde thèse de l’ouvrage : DeMille est un artiste lorsqu’il est naturaliste. Il y a un sommet de son art, et ce sont ses films naturalistes, dont le meilleur représentant est Kindling. Par naturalisme il entend une « description minutieuse de la réalité quotidienne et de ce qu’elle peut avoir de sordide. » (p.17). Par là, il balaye et atteint bien plus mortellement l’œuvre de DeMille : il n’y a pas d’art, il n’y a que du reflet. De façon tout à fait retorse, Moullet finit par accepter le diktat de la réalité. Et opérer cela à partir des films de Cecil B. DeMille, il fallait le faire ! Ce n’est pas le lieu de faire un long développement sur la question du naturalisme, cette plaie du cinéma. Mais remarquons tout de même que c’est une tendance générale des études ces dernières années de vouloir arracher Hollywood à lui-même pour le tirer vers le naturalisme. Bien plus, Moullet veut sauver DeMille de lui-même.
Plus que jamais Cecil B. DeMille demeure un cas, aussi bien par sa création artistique que par sa place dans les écrits sur le cinéma, dont les auteurs assument mal la difficulté de parler de son œuvre. Moullet a tenté de renverser les clichés critiques sur le réalisateur, mais n’a fait finalement que les reconduire, à l’envers : DeMille n’est pas qu’un réalisateur de « péplum », et ce ne sont pas ses grands succès commerciaux qui font la valeur de son œuvre. Ce qui fait la valeur de son œuvre, ce sont ces morceaux de bravoure dont on peut se moquer et ces moments naturalistes où enfin on voit la vie comme elle était à l’époque !
L’absence de critères de Luc Moullet est frappante et fatale aux films. Plus que jamais il faut réaffirmer que : l’approche auteuriste, particulièrement en ce qui concerne DeMille, est désastreuse (la personnalité du cinéaste, confondue avec son oeuvre, masque et empêche complètement l’accès aux films) ; les critères technique et économique ne constituent en rien des explications ou des justifications lorsqu’il est question d’art ; il faut parler des films en tant que films, dans leur globalité et leur sujet véritable (les prendre par petits morceaux, c’est se condamner à en rester à l’effet, et dès lors on a beau jeu de dire que DeMille fait du spectacle).
Mais sans doute Luc Moullet a-t-il fini par prendre sa maxime pour une règle d’écriture : plus c’est mauvais…
